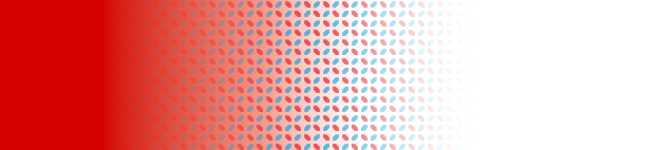Dernière modification le
Le Conseil de l’Europe
Créé en 1949, le Conseil de l’Europe est la première organisation européenne établie après la Seconde Guerre mondiale. Son installation stratégique à Strasbourg, ville symbole de la réconciliation franco-allemande, reflète la volonté des dix États fondateurs, dont le Luxembourg fait partie, de promouvoir et assurer la paix en Europe. Après la chute du mur de Berlin, le Conseil de l’Europe a véritablement étendu son action paneuropéenne. Célébrant cette année ses 75 ans d’existence, l’organisation compte 46 États membres, dont les 27 membres de l'Union européenne, représentant plus de 700 millions de personnes. L'organisation promeut et défend les principes de démocratie, des droits humains et de l'État de droit, considérés comme les piliers essentiels de la société européenne. À travers ses activités, le Conseil de l’Europe vise à créer un espace démocratique en Europe, construit sur la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et de la Cour européenne des droits de l’Homme, l’organe judiciaire indépendant qui veille au respect de ces droits.
En tant qu'organisation de coopération intergouvernementale totalement distincte et indépendante de l'Union européenne, le Conseil de l’Europe a ainsi progressivement instauré un espace juridique commun pour tous les pays européens, fondé sur plus de 220 conventions, la plupart assorties de mécanismes de suivi pour évaluer le respect des États et les inciter à remédier à leurs lacunes. Ce cadre normatif couvre un large éventail de domaines, de la protection des droits humains à la prévention de la corruption, en passant par la promotion de la diversité culturelle. En renforçant le fonctionnement démocratique des États, le Conseil de l’Europe contribue à la stabilité et à la sécurité en Europe. Ces actions sont en adéquation avec les priorités diplomatiques du Luxembourg en matière de politique étrangère, qui axe son action en faveur de la paix, du multilatéralisme et de la promotion des valeurs démocratiques.
Les principales institutions du Conseil de l’Europe sont :
· Le/la Secrétaire Général(e) et le/la Secrétaire général(e) adjoint qui ont pour attributions générales la gestion stratégique de l'organisation ;
· Le Comité des Ministres (CM) qui rassemblent les ministres des Affaires étrangères des Etats membres ou de leurs Représentants permanents. Il s’agit de l’instance de décision du CdE ;
· L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) qui est l’autre organe statutaire du Conseil de l’Europe, dont les membres sont désignés par les parlements nationaux. L’APCE a un rôle essentiellement consultatif et élit les hauts mandataires de l’organisation.
· Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, organe consultatif, qui représente les collectivités locales et régionales.
· Le/la Commissaire aux droits de l’Homme qui joue un rôle crucial dans la promotion de la protection des droits humains en surveillant les principales tendances et les problèmes rencontrés par nos sociétés en Europe. Il se rend régulièrement dans les pays et interagit avec les autorités nationales et la société civile.
Tout au long de ses 75 ans d’existence, le Conseil de l'Europe s'est adapté et a réagi aux nombreux défis bouleversants auxquels notre continent fait face. L’agression militaire russe contre l’Ukraine perpétrée depuis 2022 a mené à l’exclusion du pays agresseur et a démontré la solidarité sans faille du Conseil de l’Europe et de ses Etats-membres envers l’Ukraine. Cette solidarité a été réaffirmée lors du 4e Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement du Conseil de l'Europe, tenu à Reykjavik les 16 et 17 mai 2023. A la même occasion, de nouvelles priorités aux travaux de l’organisation ont été définies par la Déclaration de Reykjavik. Les chefs d’Etat et de gouvernement ont pris la décision importante d’établir un registre des dommages causés par l'agression menée par la Fédération de Russie, première étape vers un mécanisme international d'indemnisation. Plus généralement, ils ont convenu de renforcer l'action et la résilience du Conseil de l'Europe, de renouveler leur engagement envers la Convention européenne des droits de l'Homme et de développer des outils pour répondre aux défis posés aux droits humains par les nouvelles technologies et l'environnement.
En outre, la récente adoption de la Convention-cadre sur l'intelligence artificielle démontre également la capacité d’adaptation de l’organisation aux défis contemporains.
Pour plus d’informations sur le Conseil de l’Europe et sur le Luxembourg au sein de l’organisation.